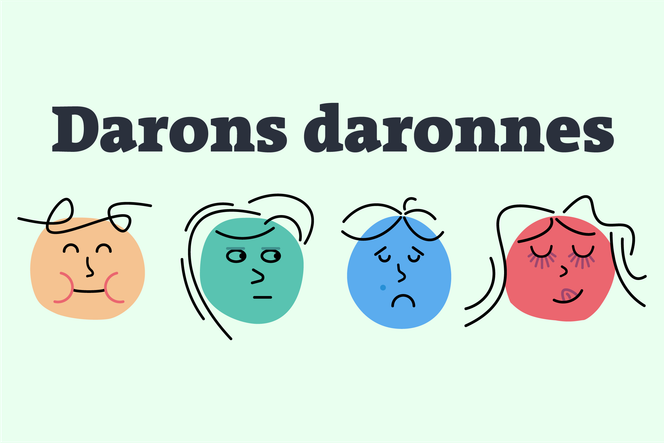
Ce billet est extrait de la newsletter hebdomadaire « Darons Daronnes » sur la parentalité, qui est envoyée tous les mercredis à 18 heures. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette newsletter en suivant ce lien.
Mes parents n’ont jamais été militants. Quand j’étais jeune, ma mère m’a emmenée aux grandes manifestations de l’époque ; je les ai entendus discuter de politique ; ils nous ont parlé des valeurs auxquelles ils adhéraient. Mais bien qu’ils aient été vingtenaires en 1968, ils sont toujours demeurés à l’écart des luttes, portant un regard sympathisant mais distant sur ce qu’ils considéraient comme des causes justes défendues, selon eux, avec trop de dogmatisme.
Je ne connais donc pas ces réunions enfumées que décrivent certains enfants de soixante-huitards, comme Virginie Linhart ou Maurice Barthélemy. J’ignore aussi comment ces combats rejaillissent sur les enfants, s’ils en reprennent le flambeau, si les idées de leurs parents infusent dans leur vie d’adulte.
C’est avec ce questionnement que la sociologue Camille Masclet est allée à la rencontre de féministes de la deuxième vague, celle des années 1970, et de leurs enfants. Pendant dix ans, de 2007 à 2017, elle a interrogé des femmes ainsi que leurs enfants, devenus adultes, pour tâcher de comprendre si cette nouvelle génération portait « le féminisme en héritage » (le titre de son livre paru aux PUF, 316 pages, 23,90 euros).
Il vous reste 81.95% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

